
La Torah établit plusieurs commandements concernant le ‘Hametz pendant Pessah’:
- Le commandement positif d’ôter tout le ‘Hametz de sa maison (Chemot XII:15 ss.)
- L’interdiction de posséder du ‘Hametz (Chemot 12:19, Devarim XVI:4)
- L’interdiction de consommer du ‘Hametz ou des mélanges contenant du ‘Hametz (Chemot XII:3 et XII:20, Devarim XVI:3). Sur place, la Torah énonce également un fondement spécifique à cette obligation :
וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶל־הָעָ֗ם זָכ֞וֹר אֶת־הַיּ֤וֹם הַזֶּה֙ אֲשֶׁ֨ר יְצָאתֶ֤ם מִמִּצְרַ֙יִם֙ מִבֵּ֣ית עֲבָדִ֔ים כִּ֚י בְּחֹ֣זֶק יָ֔ד הוֹצִ֧יא יְהֹ אֶתְכֶ֖ם מִזֶּ֑ה וְלֹ֥א יֵאָכֵ֖ל חָמֵֽץ׃שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים תֹּאכַ֣ל מַצֹּ֑ת וּבַיּוֹם֙ הַשְּׁבִיעִ֔י חַ֖ג לַיהֹ׃מַצּוֹת֙ יֵֽאָכֵ֔ל אֵ֖ת שִׁבְעַ֣ת הַיָּמִ֑ים וְלֹֽא־יֵרָאֶ֨ה לְךָ֜ חָמֵ֗ץ וְלֹֽא־יֵרָאֶ֥ה לְךָ֛ שְׂאֹ֖ר בְּכׇל־גְּבֻלֶֽךָ׃
Et Moïse dit au peuple: « Souviens-toi de ce jour où vous êtes sortis de l’Égypte, de la maison de servitude et vous ne mangerez pas de ’hametz. Sept jours tu mangeras de la Matsah et le septième jour fête pour Hashem. Des Matsot tu mangeras pendant ces sept jours et l’on ne verra pas de ‘hametz et l’on ne verra pas de levain dans tes domaines ”.
(Chemot XII:3 ss.)
שָׁמוֹר֙ אֶת־חֹ֣דֶשׁ הָאָבִ֔יב וְעָשִׂ֣יתָ פֶּ֔סַח לַיהֹ אֱלֹ-הֶ֑יךָ כִּ֞י בְּחֹ֣דֶשׁ הָֽאָבִ֗יב הוֹצִ֨יאֲךָ֜ יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ מִמִּצְרַ֖יִם לָֽיְלָה׃
(…)
לֹא־תֹאכַ֤ל עָלָיו֙ חָמֵ֔ץ שִׁבְעַ֥ת יָמִ֛ים תֹּֽאכַל־עָלָ֥יו מַצּ֖וֹת לֶ֣חֶם עֹ֑נִי כִּ֣י בְחִפָּז֗וֹן יָצָ֙אתָ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם לְמַ֣עַן תִּזְכֹּ֗ר אֶת־י֤וֹם צֵֽאתְךָ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם כֹּ֖ל יְמֵ֥י חַיֶּֽיךָ׃וְלֹֽא־יֵרָאֶ֨ה לְךָ֥ שְׂאֹ֛ר בְּכׇל־גְּבֻלְךָ֖ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים וְלֹא־יָלִ֣ין מִן־הַבָּשָׂ֗ר אֲשֶׁ֨ר תִּזְבַּ֥ח בָּעֶ֛רֶב בַּיּ֥וֹם הָרִאשׁ֖וֹן לַבֹּֽקֶר׃
וְלֹֽא־יֵרָאֶ֨ה לְךָ֥ שְׂאֹ֛ר בְּכׇל־גְּבֻלְךָ֖ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים וְלֹא־יָלִ֣ין מִן־הַבָּשָׂ֗ר אֲשֶׁ֨ר תִּזְבַּ֥ח בָּעֶ֛רֶב בַּיּ֥וֹם הָרִאשׁ֖וֹן לַבֹּֽקֶר׃
Garde le mois du printemps, et tu feras Pessah’ pour Hashem, ton Dieu; car c’est le mois du printemps qu’Il t’a sorti, Hashem, ton Dieu, d’Égypte, la nuit. (…) Tu ne mangeras pas de ‘Hametz levé (ou “de ‘hametz de causalité”), sept jours tu mangeras dessus des matsot pain de misère, car c’est avec précipitation que tu as quitté le pays d’Égypte, et il faut que tu te souviennes, tous les jours de ta vie, du jour où tu as quitté le pays d’Égypte. Et l’on ne verra pas chez toi du levain dans tes domaines pendant sept jours et qu’il ne reste rien le lendemain de la viande offerte en sacrifice le soir du premier jour.
(Devarim XVI:1 ss.)
Le Talmud, pour sa part, contient plusieurs textes fondamentaux qui traitent de l’obligation de recherche et d’élimination du ‘Hametz avant Pessah. Ces sources constituent la base halakhique de cette pratique essentielle.
Le traité Pessahim est la source talmudique principale concernant les lois du ‘Hametz. La première michna de ce traité établit clairement l’obligation de recherche :
מַתְנִי׳ אוֹר לְאַרְבָּעָה עָשָׂר בּוֹדְקִין אֶת הֶחָמֵץ לְאוֹר הַנֵּר. כׇּל מָקוֹם שֶׁאֵין מַכְנִיסִין בּוֹ חָמֵץ, אֵין צָרִיךְ בְּדִיקָה. וּבַמָּה אָמְרוּ ״שְׁתֵּי שׁוּרוֹת בַּמַּרְתֵּף״ — מָקוֹם שֶׁמַּכְנִיסִין בּוֹ חָמֵץ. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁתֵּי שׁוּרוֹת עַל פְּנֵי כׇּל הַמַּרְתֵּף, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שְׁתֵּי שׁוּרוֹת הַחִיצוֹנוֹת שֶׁהֵן הָעֶלְיוֹנוֹת.
Le soir du quatorze du mois de Nissan, on cherche du pain levé dans sa maison à la lumière d’une bougie. Il n’est pas nécessaire de chercher dans un endroit où l’on n’a pas l’habitude d’apporter du pain levé, car il est peu probable qu’il y ait du pain levé à cet endroit. Quant à savoir ce que les Sages des générations précédentes voulaient dire lorsqu’ils affirmaient qu’il fallait fouiller deux rangées de tonneaux de vin dans une cave, c’est-à-dire un endroit où l’on emporte habituellement du pain levé, les premiers tanna’im ne s’entendent pas sur ce point. Beit Shammai dit qu’il s’agit de fouiller les deux premières rangées dans toute la cave, et Beit Hillel dit : « Il n’est pas nécessaire de fouiller aussi loin : Il n’est pas nécessaire de fouiller aussi loin, puisqu’il suffit de fouiller les deux rangées extérieures, qui sont les rangées supérieures.
Cette michna fondamentale établit donc le moment précis et la méthode de la recherche du ‘hametz, sans avoir même défini ce qu’est le ‘hametz.
Comme si ce qu’il incombe de chercher était d’une importance moindre que la temporalité précise (le 14 Nissan au soir) et les modalités (à la lumière d’une bougie, la localisation de la recherche faisant l’objet d’un débat) de cette recherche.
La notion même de ‘Hametz demeure donc à ce stade confuse puisque cette première Michna ne le définit pas et que les versets précités de Chemot mentionnent simultanément le ‘hametz et le levain. A cet égard, les Sages vont interpréter le verset de Chemot XII,20 :
כׇּל־מַחְמֶ֖צֶת לֹ֣א תֹאכֵ֑לוּ בְּכֹל֙ מוֹשְׁבֹ֣תֵיכֶ֔ם תֹּאכְל֖וּ מַצּֽוֹת
Vous ne mangerez d’aucune pâte levée (ma’hmétset) ; dans toutes vos demeures vous mangerez des azymes
De là, les sages apprennent que l’interdit de consommation porte non seulement sur une chose qui a fermenté par elle-même, mais également sur toute chose qui a fermenté par l’effet d’un agent levant extérieur (comme le levain, la levure). On n’entrera pas ici dans la distinction halakhique entre le levain et la levure.
Sur un plan technique, un boulanger ou un pâtissier dirait sans doute que la levure est un micro-organisme unicellulaire appartenant au règne des champignons, tandis que le levain est un agent de fermentation naturel obtenu à partir d’un mélange de farine et d’eau qu’on laisse fermenter spontanément. Cette fermentation est possible grâce à la présence naturelle de levures sauvages et de bactéries lactiques dans la farine et dans l’air ambiant. Sa création nécessite plusieurs jours, voire semaines, de « rafraîchissements » réguliers (ajouts de farine et d’eau). Levure et levain sont tous deux des agents de fermentation qui permettent à la pâte de lever. La levure agit rapidement (quelques heures). Le levain nécessite des temps de fermentation beaucoup plus longs (12 à 24 heures ou davantage). Le levain et la levure symbolisent le passage du temps, incarnant matériellement la durée dans notre alimentation. Ils fonctionnent comme une montre dont les aiguilles, en parcourant le cadran circulaire, transforment la distance en mesure du temps écoulé.
Ce rapport au temps se retrouve également dans la confection de la Matsah. Non pas en termes d’heures comme pour la levure ou le levain, mais en termes de minutes, en termes d’urgence et de chronomètre.
En effet, le Talmud et les commentateurs ultérieurs définissent précisément le processus qui transforme les cinq céréales (blé, orge, épeautre, avoine et seigle) en ‘Hametz. Pour qu’il y ait ‘Hametz, deux critères suffisent : premièrement le contact de l’une des cinq céréales avec l’eau ou un autre liquide et, deuxièmement, un temps de fermentation suffisant, traditionnellement fixé à 18 minutes.
Cette durée provient d’une discussion talmudique (Pessahim 46a) :
אִם אֵין שָׁם כַּיּוֹצֵא בּוֹ מַהוּ אֲמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: כְּדֵי שֶׁיֵּלֵךְ אָדָם מִמִּגְדַּל נוּנַיָּא לִטְבֶרְיָא מִילנֵימָא מִיל הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּשִׁיעוּרָא דְּמִיל כְּמִמִּגְדַּל נוּנַיָּא וְעַד טְבֶרְיָא.
Rabbi Abbahu rapporte que Rabbi Shimon ben Lakish a dit : Selon les Sages, le levain se produit pendant le temps qu’il faut à une personne pour parcourir la distance entre Migdal Nunaya et Tibériade, qui est d’un mil, soit deux mille coudées. Cette déclaration nous apprend incidemment que la longueur d’un mille est la distance entre Migdal Nunaya et Tibériade.
Plus loin, le traité Pessahim (94a) discute différentes évaluations sur le temps de cette marche entre Migdal Nunaya et Tibériade, dont trois temps différents pour parcourir un mille sont dérivés : 18 minutes, 22,5 minutes et 24 minutes.
Un mille étant lui même défini comme « deux mille coudées », soit environ un kilomètre (Rashi dans Yoma 67a établit l’équation 1 mille = 2 000 coudées), on conviendra que nos Sages ne pratiquaient pas le jogging.
En effet, selon le Mishna Berura (301-3), la marche régulière d’une personne correspond à une distance d’une coudée entre l’arrière d’un pied et l’arrière de l’autre pied, ce qui laisse environ une demi-coudée (environ 11 pouces) entre les pieds. Un mille représentant 2 000 pas, si l’on calcule 18 minutes multipliées par 60 secondes, on obtient 1 080 secondes, ce qui signifie que la personne fait environ deux pas par seconde. Cette cadence n’est pas particulièrement rapide lorsqu’on considère la taille des pas telle que définie par les Sages. La perception moderne d’une marche plus rapide s’explique par le fait que nous écartions davantage nos pieds que ce que prescrivent les textes traditionnels.
Quoi qu’il en soit, ces 18 minutes vont évidemment faire l’objet de codifications halakhiques. Rambam (Maïmonide) dans son Mishné Torah (Hilkhot Chametz U-Matza -Lois du ‘Hametz et de la Matsa 5:13), codifie cette règle en déclarant : « Si la pâte a reposé pendant le temps qu’il faut à un homme pour marcher un mil, elle est devenue ‘hametz et doit être brûlée immédiatement. » Le Choulhan Aroukh (Orah Haïm 459:2) reprend également cette règle. Pour la préparation de la matsa, on adopte la durée la plus courte, soit 18 minutes, par mesure de précaution.
Si la règle des 18 minutes s’applique initialement à une pâte laissée au repos, les décisionnaires ultérieurs l’ont appliquée de manière plus stricte à l’ensemble du processus de préparation de la matsa, du moment où la farine entre en contact avec l’eau jusqu’à la fin de la cuisson.
En effet, selon Rambam, sur place : « Tant qu’on pétrit activement la pâte, même pendant toute la journée, la pâte ne devient pas ‘Hametz. Si, cependant, on arrête de travailler la pâte et qu’on la laisse reposer, et qu’elle atteint un stade où elle produira un son si on la frappe, elle est devenue ‘Hametz et doit être brûlée immédiatement. Si, cependant, elle ne produit pas de son, si elle a été laissée pendant le temps qu’il faut pour marcher un mil, elle a levé et doit être brûlée immédiatement. » Ainsi, le Maître de Fostat indique clairement que la règle des 18 minutes s’applique spécifiquement à une pâte qui a été pétrie puis laissée au repos sans être travaillée. Le Choulhan Aroukh (encore Orah Haïm 459:2) codifie cette règle en déclarant : « On ne doit pas laisser la pâte sans la travailler, même pour un instant. Tant qu’on travaille la pâte, même pendant toute la journée, elle ne devient pas ‘hametz. Si on laisse la pâte sans la travailler pendant un mille, alors elle devient ‘hametz. La période d’un mille est de 18 minutes”.
L’interprétation stricte qui applique les 18 minutes à l’ensemble du processus, de la mise en contact d’un liquide avec la farine jusqu’au terme de la cuisson, au lieu de la fin du pétrissage au terme de la cuisson, provient de plusieurs sources post-talmudiques. Ainsi, le Riaz (Rabbi Yeshaya Aharon Zilberstein), cité par le Bach (Rabbi Yoel Sirkis) dans son commentaire sur le Tur Orah Haïm 459, est l’une des premières autorités à adopter cette position stricte. Selon lui, « le travail sur la Matzah n’interrompt pas les 18 minutes, et donc toutes les Matzas doivent être cuites dans les 18 minutes suivant le début du pétrissage. » Le Rama (Rabbi Moshe Isserles), dans ses commentaires sur le Choulhan Arukh (Orah Haïm 459:2) ajoute une dimension de rigueur : « On doit être strict concernant la fabrication des matzot, car on doit craindre que même de brèves interruptions [dans le travail de la pâte] ne s’additionnent jusqu’à atteindre le temps d’un mil, ou que la pâte ne se trouve dans un endroit chaud qui accélère le processus de fermentation. »Le Maharil (Rabbi Yaakov ben Moshe Moelin, 51) et l’Aruch Hashulchan (459:7) soutiennent également cette position stricte. De même que le Pniné Halakha (chapitre 2, section 4) du Rav Eliezer Melamed, qui explique que les décisionnaires ultérieurs, prenant en compte les opinions minoritaires parmi les rishonim, ont statué que nous devrions être particulièrement stricts concernant Pessah en appliquant la limite de 18 minutes à l’ensemble du temps de préparation de la pâte, même si elle n’est pas laissée au repos.
Ainsi, la pratique dorénavant commune d’inclure également le temps de cuisson dans cette limite de 18 minutes semble être le résultat d’une couche supplémentaire de rigueur, utilisant l’interprétation la plus stricte possible de la règle, bien qu’aucune source textuelle précise ne soit mentionnée pour cette extension particulière.
Ainsi, pour résumer :
- Le ‘Hametz, c’est du temps,
- La Bedikat ‘Hametz et le Bitoul, c’est la recherche, à la lueur tremblotante d’une bougie, du temps qui aurait pu être perdu et l’annulation de ce temps perdu,
- “Rav Hisda a dit: ‘Et il doit l’annuler dans son cœur.’“(Pessahim 31b), ce qui laisse entendre que même pour le ‘hametz physiquement inaccessible, l’annulation mentale reste nécessaire pour lui conférer une vigueur juridique,
- La Matsah, c’est également du temps, mais du temps de rigueur, du temps retrouvé.
Il n’aura pas échappé au lecteur que le “temps retrouvé” et “à la recherche de la matsah perdue” constituent de fort grossières allusions à l’oeuvre de Proust.
Élevé dans la religion catholique, baptisé puis confirmé,Proust, fils du coté paternel, d’une famille catholique de Normandie, descendait, du côté maternel, d’une famille juive d’Alsace. Dans « Du côté de chez Swann », premier tome d’ « À la recherche du temps perdu », les souvenirs de pâtisseries remontent à la mémoire du narrateur :
« Un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques.»
(…)
«Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. »
(…)
« Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût c’était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray […] ma tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. »
(…)
« La vue de la petite madeleine ne m’avait rien rappelé avant que je n’y eusse goûté […]. Mais, quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir. »
(…)
«Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante […] aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre […] et avec la maison, la ville, la Place où on m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des courses depuis le matin jusqu’au soir et par tous les temps, les chemins qu’on prenait si le temps était beau […] et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. »
Évidemment, l’épisode de la madeleine constitue l’un des passages les plus célèbres de la littérature française et illustre parfaitement la conception proustienne de la mémoire involontaire. Cette scène est devenue si emblématique qu’elle a donné naissance à l’expression « madeleine de Proust », désignant tout élément sensoriel capable de déclencher une réminiscence involontaire. La particularité de cette expérience réside dans son caractère fortuit et sensoriel.
Comme le souligne Proust lui-même, « la vue de la petite madeleine ne m’avait rien rappelé avant que je n’y eusse goûté ». Cette observation met en lumière la hiérarchie sensorielle établie par l’auteur, où les sens du goût et de l’odorat occupent une place privilégiée dans l’accès aux souvenirs profonds. Ces sens, plus archaïques et moins intellectualisés que la vue, semblent avoir conservé une connexion plus directe avec sa mémoire affective.
Dans l’œuvre proustienne, les pâtisseries ne sont pas de simples objets de consommation mais deviennent des métaphores complexes du temps et de la mémoire. La madeleine, en particulier, incarne la fragilité et la persistance paradoxales du souvenir. Comme l’écrit Proust, les odeurs et les saveurs sont « plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles » que les objets matériels. Cette description évoque la nature paradoxale de la mémoire : à la fois éphémère et durable, insaisissable et pourtant capable de porter « l’édifice immense du souvenir ».
La comparaison entre la « gouttelette presque impalpable » de saveur et « l’édifice immense du souvenir » qu’elle soutient illustre parfaitement la disproportion entre le stimulus sensoriel et la richesse du monde intérieur qu’il révèle. Cette disproportion est au cœur de l’expérience proustienne du temps : un instant présent peut contenir en lui l’immensité du passé, abolissant ainsi la distinction conventionnelle entre les dimensions temporelles.
L’épisode de la madeleine et les autres références aux pâtisseries dans l’œuvre de Proust révèlent une conception profondément originale du temps et de la mémoire. Cette jouissance de l’étonnement face à la résurgence du passé dans le présent constitue l’une des expériences fondamentales de « À la recherche du temps perdu ». À travers la madeleine et d’autres pâtisseries, Proust redécouvre cette capacité d’émerveillement face aux mystères de sa propre mémoire, et à reconnaître dans les sensations les plus ordinaires les clés d’accès à son temps perdu.
Posons ici une hypothèse.
La dimension énorme de la pâtisserie/’hametz dans la mémoire proustienne occulte le souvenir invécu d’une matsah jamais consommée et du temps retrouvé qu’elle exprime.
Le « temps retrouvé » constitue l’aboutissement de la réflexion proustienne sur le temps, la mémoire et l’identité. Il représente le point culminant de son œuvre monumentale « À la recherche du temps perdu ».
Pour Proust, le « temps retrouvé » représente avant tout une libération des contraintes du temps chronologique.C’est très exactement ce qui se joue durant le seder de Pessah’ ; comme chacun sait, il ne s’agit pas de commémorer un événement historique – comme le défilé du 14 juillet commémore la prise de la Bastille de 1789 et la Fête de la Fédération du de 1790 -, il s’agit de vivre au temps présent l’expérience ancienne de la libération.
Dans le dernier tome de son œuvre, Proust écrit qu’une « minute affranchie de l’ordre du temps a recréé en nous pour la sentir l’homme affranchi de l’ordre du temps ». Cette formulation révèle la dimension presque métaphysique de sa conception : le temps retrouvé permet d’échapper à la tyrannie de la temporalité linéaire. Le seder de Pessah’ produit le même effet. On voit bien ici le contraste saisissant entre le temps retrouvé proustien et la rigueur halakhique du comput des 18 minutes pour la préparation de la matsah.
Proust suggère que nous pouvons nous affranchir du temps et l’appréhender d’une manière différente. Comme le souligne Jean-Yves Tadié, grand spécialiste de son œuvre, « la mémoire annule le temps ». Certes, cette annulation n’est pas une simple négation, mais plutôt une transcendance qui permet d’accéder à une réalité plus profonde. Comme pour ceux qui célèbrent Pessah’ en commençant par annuler le ‘Hametz/temps perdu, elle constitue pour l’auteur le moyen d’accéder au temps retrouvé.
Ainsi l’oeuvre monumentale pourrait-elle se lire comme une recherche de la Matsah perdue, une quête inouïe et impossible du pain de misère que mangeaient ses (nos) ancêtres ; ancêtres hébreux dont Proust, comme beaucoup d’autres, a été coupé par le jeu de dupes de l’histoire familiale.
Ceux qui ont la chance d’annuler effectivement le ‘Hametz sans devoir rédiger pour ce faire quelques milliers de pages peuvent trouver là un aliment supplémentaire pour se réjouir de Pessah’, de la Matsah retrouvée et des nuits de lecture de la Haggada, finalement bien courte si on la compare au texte proustien. Mieux que la légèreté proustienne, la rigueur qui s’applique aux 18 minutes et à toute le durée de Pessah’ sont l’accès à la Matsah retrouvée et à sa joie.
Marc Lipskier
10 avril 2025 – 12 Nissan 5785






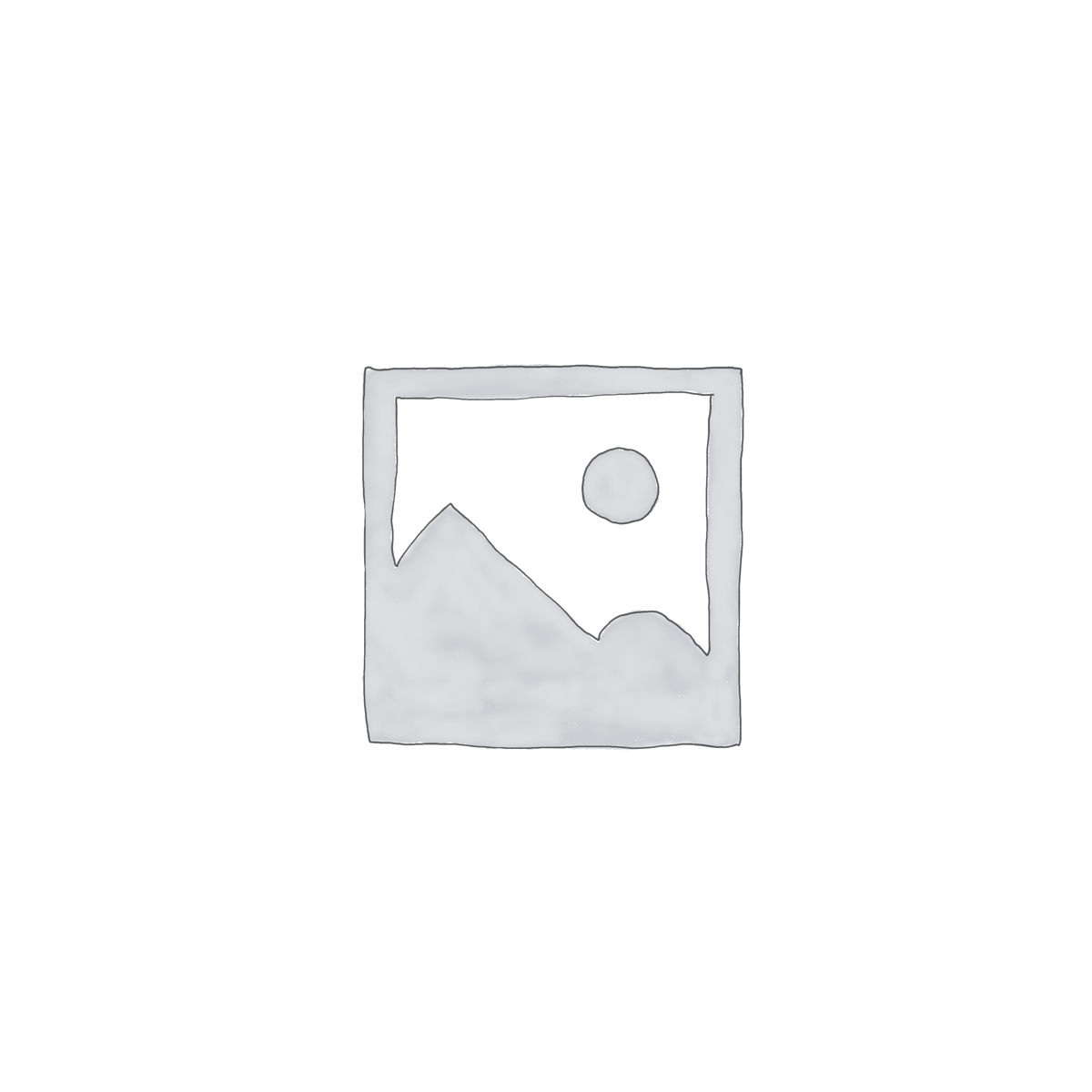


Esther –
Le titre même, évidemment, évoque Proust. J’ai trouvé votre parallèle entre la recherche du temps perdu, le seder, la fabrication de la matsa , d’une grande originalité. Belle analyse du temps proustien et du temps halahique.